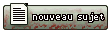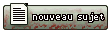Elite Troups

-= Chaos Elite Troops =-
Inscription le 06-07-02
Messages : 1574
 Age : 42 ans Age : 42 ans
Lieu de résidence : Sur la Frontiere
|

|
|
|
|
 PLC 2008 - Léthé a été posté le : 16/01/09 20:45
PLC 2008 - Léthé a été posté le : 16/01/09 20:45
|
Et hop, comme on ne peut pas juste critiquer durement ses petits camarades dans la vie, des fois, comme ça, j'écris des trucs. Qui ne rencontrent que moyennement d'échos, mais bon, c'est un peu ma faute, la prochaine fois je ferai juré ET participant, ça me filera des points.
Procédons donc.
Bon c'est ignoble à lire, mais je ne vois pas trop comment découper le texte pour aérer. Si vous avez des suggestions, je prends.
Il pleut. Ce n’est pas la jolie bruine littorale qui nous trempe sans qu’on s’en rende compte, ce n’est pas l’averse de campagne qui soulève de lourdes odeurs de terre. Non, c’est une pluie urbaine, qui claque sur le sommet des immeubles et qui dégouline dans des gouttières crasseuses. C’est un rideau gris qui tombe en grosses gouttes graisseuses, qui dessine des arcs-en-ciel huileux sur le sol, qui se précipite dans des caniveaux jonchés d’ordures entraînées vers l’égout. Les voitures passent, essuie-glaces battant en cadence, pneus chuintant sur l’asphalte humide, projetant des trombes d’eaux sur les piétons maussades. Du ciel sale ne filtre aucune lumière, ce pourrait être l’aube comme le crépuscule. Le ballet urbain n’indique rien non plus, à toute heure du jour, c’est la même procession bruyante de conducteurs et de piétons. De mon étage, appuyé contre une fenêtre, j’observe mes concitoyens. Je devrais probablement être en train d’écrire, je dois finir une nouvelle pour un concours quelconque. Ce n’est pas que le prix soit particulièrement intéressant, mais l’orgueil me commande d’y participer.
Je n’arrive pas à écrire maintenant.
Autant regarder les gens, en bas, qui s’agitent sous la pluie. L’averse s’entête, opiniâtre, ne faiblit pas. Des bourrasques brutales giflent d’eau ma fenêtre, estompant les silhouettes grises de la rue. Mêlée de suie, la pluie trace des signes étranges sur la surface de verre. On pourrait penser que la pluie purifie la ville, qu’elle balaie la saleté, la pollution, qu’elle force les habitants à déserter les rues et les automobilistes à interrompre leur trajet. Ce serait se tromper. La pluie n’embellit pas la ville. Tout au plus contribue-t-elle à exacerber ce qui la rend insupportable. Les trottoirs s’encombrent de parapluies trop grands qui gênent les déplacements de ceux qui courent vers un refuge. Les hordes automobiles gla*******ent impatiemment. La poussière est plaquée au sol par l’averse, engluant le pavé, attendant seulement de sécher pour remplir à nouveau nos poumons. La pluie n’embellit pas la ville. Rien ne saurait l’embellir. Je semble amer à pontifier sur la ville et ses laideurs. Je pourrais quitter cet endroit, cet appartement minable, je pourrais trouver un séjour qui choquerait moins mon sens esthétique. Rien ne me retient vraiment ici. Mais j’aime cette ville. Fascination morbide. J’aime les bâtiments gris cernés de noir qui flanquent les grands boulevards, j’aime les ruelles tortueuses qui veinent le centre, j’aime les places nues où ne s’aventurent que les pigeons et les clochards. J’aime les absurdes sculptures d’art moderne qui rouillent sur des socles de béton, les jardinières de fleurs fanées et les murales défigurées par les tags. J’aime observer la circulation dans les artères commerciales, les trajectoires chaotiques des imprudents qui remontent le courant. J’aime me souvenir qu’ici j’ai vécu les années les plus amusantes de ma vie, partagées avec une joyeuse bande d’amis dans des bars enfumés, des cinémas bondés, des théâtres désertés, des appartements exigus. J’aime me souvenir des moments passés seul avec elle, lui étreignant la main dans des bars enfumés, l’embrassant dans des cinémas bondés, la caressant dans des théâtres désertés, l’aimant dans un appartement exigu. Ils sont partis maintenant. Tous. Je suis resté, dernier témoin de ces années perdues, de cette amitié victime de la géographie. Si je quitte cette ville, il ne restera rien, comme si tous ces moments n’avaient jamais existé. S’en souviennent-ils ? Impossible. Pas comme je m’en souviens, pas sans marcher dans ces rues chargées de souvenirs. Pas comme je m’en souviens, pas sans regretter tous les jours d’être celui qui reste, celui qu’on abandonne alors qu’on va refaire sa vie ailleurs. La pluie ne me vaut rien. Stupides regrets. Dès que je pense au passé, elle m’assaille, insupportable, la nostalgie, le plaisir d’avoir de la peine. Il faudra bien que je m’y fasse, les temps changent. Je ne retrouverai jamais le goût particulier de ces années. Il y aura d’autres moments, d’autres amis, d’autres amours. Peut-être.
J’ai besoin de me changer les idées. Marcher un peu, la tête vide, regarder les gens. Cela vaut mieux que de rester ici à ruminer dans l’obscurité. La pluie tombe toujours. J’enfile une tenue appropriée et je sors. Une odeur de poussière mouillée m’accueille au sortir de l’immeuble. J’observe un instant les filets d’eau qui ruissellent du toit, à l’abri sous le porche du bâtiment. Je me décide enfin et affronte l’averse. Des gouttes froides frappent ma figure. D’autres crépitent contre la capuche de mon imperméable. En quelques secondes, mon visage est baigné d’eau crasseuse. Ma tenue adéquate ne garantit pas un abri total. Peu importe. Ayant la chance d’habiter près du centre-ville, j’ignore le tramway qui s’arrête à quelques mètres et décide de m’y rendre à pied. La machine mugit en démarrant et me dépasse bientôt. Dans son ventre lumineux sèchent des utilisateurs à la mine grise dont les vêtements gouttent sur le sol. Ses vitres s’embuent d’une moiteur que je devine pénible. Le tram s’éloigne, enjambe la rivière. L’épais rideau de pluie étouffe sa plainte. J’emprunte à mon tour le pont. Quelques mètres en dessous, l’eau moutonne, une touche de jaune boueux infectant sa grisaille ordinaire. Les berges disparaissent sous les flots enflés. Quelques arbres dressent leurs branches noires hors de l’eau. Autour des troncs s’accumule une mousse compacte écœurante. La pluie ne nettoie pas non plus les cours d’eau. Le vent me cueille au milieu du pont, s’engouffre sous mes vêtements, gonfle grotesquement mon imperméable. J’allonge le pas, pressé d’échapper au souffle inquisiteur. Je m’abrite bientôt entre des rangées de bâtiments et le vent abandonne. La pluie, elle, persévère, implacable. Je suis trempé. Au temps pour mes précautions. Je poursuis ma route, évitant les cataractes qui se précipitent des toits. Je croise quelques passants pressés, crispés de contrariété. Leurs enjambées brutales arrachent des gerbes grises au trottoir inondé. Je dépasse des bureaux illuminés. À l’intérieur, imperturbables, des employés exécutent leurs tâches quotidiennes. Curieux contraste entre le crépuscule pluvieux de la rue et le zénith doux des bureaux. Devant l’hôpital, des infirmiers en pause contemplent sans les voir les rampes de skate abandonnées. Personne ne manifeste sa rébellion ici aujourd’hui. J’imagine qu’ils doivent mener leurs batailles anticonformistes dans les magasins lumineux qui brillent là-bas, à quelques centaines de mètres, phares dans la tempête. Je traverse un rond-point, coupe par une molle pelouse municipale et prend pied sur le pavé uni de la place du commerce : une large esplanade dallée de béton, entourée de cafés désertés. Réfugiés sous l’auvent du cinéma, des pigeons gonflés contemplent d’un œil rouge les crépitements qui agitent les flaques immenses dans lesquelles je patauge. Cette place est moche. Trop exposée. Je n’aime pas la traverser, encore moins quand je suis le seul à le faire. Je me réfugie dans une des venelles qui rayonnent de la place. Elle pue la *******e, comme il se doit. De toute façon, dans cette partie de la ville, c’est ça ou l’odeur des ordures amoncelées par les restaurateurs. Les grandes avenues sont bien proprettes, récurées pour les chalands, mais l’envers du décor est nettement moins reluisant. La pluie tombe, se mêle à des humeurs dont on préfère ne rien savoir, court entre les pavés glissants. Souvenirs de nuits douces, d’un groupe animé empruntant ces passages en riant trop fort après la fermeture des bars. Les rues alors ne semblaient pas si tristes, ne se liquéfiaient pas sous une ondée poisseuse. Je n’ai plus un os de sec. Je débouche dans une de ces belles avenues, bordée de bijouteries et de parfumerie. Les lieux portent le deuil de la faune habituelle de cocottes en goguette gloussant sur les trottoirs par troupeau de six. Dans les entrées désolées, des vendeuses scrutent la rue tristement, rêvent à ce qu’elles auraient pu faire de cette journée gâchée à attendre une clientèle qui ne viendra pas. Nous ne fréquentions pas ces quartiers. Du centre, nous connaissions surtout les bars que nous investissions tard le soir, après avoir vidé les réserves de ceux chez qui nous nous étions retrouvés. En voici un, justement, que nous honorions parfois de notre présence. Changement d’administration, d’enseigne, de décor. Un autre souvenir enterré. Un jour, tout aura disparu et rien ne me retiendra plus ici. Un jour.
Encore pris au piège hein ? Pas moyen de me sortir ces idées mornes de la tête. Je vis dans un monde qui n’existe plus, j’éprouve des sensations qui ont disparu, je cherche quelque chose qui ne se trouve plus ici. Je tourne au hasard dans les rues, je m’éloigne du centre, trop hanté à mon goût. Je m’engage sur un large boulevard qui s’étire entre des bâtiments administratifs trapus. Revoilà la ligne de tram. Sous les abris, quelques personnes attendent qu’on vienne les cueillir. Je les dépasse et continue ma route vers nulle part. J’emprunte le passage piétonnier qui jouxte les rails. Je longe à présent les rives d’un cours d’eau. Cette ville s’élève sur les flots. On a recouvert en partie un affluent du fleuve et bâti dessus. Les édifices tordus souffrent de la flaccidité du sol. Le goudron de la chaussée laisse abruptement place à une rivière morne aux teintes de béton. L’eau clapote doucement, brouillée de pluie. Quelques rafiots ondulent le long de la berge de ciment, attachés à de larges anneaux de métal rouillé. Ce tableau gris suscite une indicible tristesse. Il évoque la dégradation, l’inéluctable victoire du pourrissement. Des écailles de peinture crasseuses se détachent des flancs lépreux des embarcations. Des paquets noirs d’algues gluantes envahissent les cordes qui les amarrent au quai. L’agitation légère de la rivière les secoue de soubresauts lugubres sous la lumière blafarde. Charon compléterait pertinemment la scène. La berge décrit une large courbe au-delà de laquelle je peux observer un horizon dénué d’immeuble. Au loin, le ciel, opilé de nuages plombés, se confond avec l’onde amère, horizon de grisaille encadré de béton. Des grues sombres élèvent leurs becs d’acier au dessus des constructions, mauvais oiseaux augurant l’érection de nouveaux cubes de ciment le long de l’eau grise, de nouveaux monuments glorifiant la laideur fonctionnelle. Non loin de moi, au milieu de cette infinité monotone, flotte une petite île couverte d’arbres tristes assoiffés de lumière. Une passerelle branlante permet de rejoindre cette végétation moribonde. Je m’engage sur les planches glissantes, tournant le dos à la laideur urbaine, souhaitant un instant sentir autre chose que des pavés sous mes semelles, toucher autre chose que des murs de ciment, respirer autre chose que des gaz d’échappement. Rien qu’un instant hors de la ville, sous les arbres, sous la pluie. Les sentiers de l’île sont de boue liquéfiée, jaunâtre, trop fluide pour coller à mes semelles. La pluie chuchote sur des milliers de feuilles. Il fait nuit sous les branches humides. Je m’en trouve apaisé. Je pourrais rester ici pendant toute l’averse, écoutant le martèlement des gouttes, sondant l’obscurité glacée, le corps trempé, les pieds dans la boue. Je pourrais rester ici pendant toute l’averse et prétendre que j’ai quitté la ville, que je commence une nouvelle vie, seul, loin de tout. Je m’aventure entre les troncs suintants, couverts de lichens, enlacés par le lierre. Les contours d’une place circulaire émergent de l’ombre, illuminés par une trouée des cimes. La pluie s’accumule en un bassin boueux, agité de discrètes vaguelettes qui lèchent les pieds de bancs abîmés. Je navigue vers un des bancs. Il est trempé, évidemment. Qu’importe, je ne risque pas d’empirer mon état. Je m’assois lourdement, accablé soudain par je ne sais quelle humeur sinistre. Cela arrive parfois, je me sens vide, comme si rien ne motivait ma vie, comme si je ne pouvais espérer que le lent et insignifiant écoulement de mes jours. Ce n’est pas désagréable en fait, je suis un automate sans objectif, une machine vide. Je ne ressens ni joie, ni peine, je suis juste l’abîme. Cela persiste quelque temps, puis s’enfuit, je m’intéresse de nouveau à mon entourage, je m’enthousiasme, je ris, le genre de choses que fait tout le monde. De grosses gouttes explosent autour de moi, coulent dans mon dos, sur mon visage, mes lèvres. Mes cheveux, se plaquent sur mon crâne et gouttent lentement. Je suis liquide.
Le vent s’exaspère et rugit entre les troncs. Une clarté crépusculaire imprègne les alentours. Je ne suis pas seul. En face de moi, sur un banc perdu dans l’ombre, une silhouette se détache dans la pauvre lumière. Je ne l’avais pas remarqué, obnubilé par mes idées noires. C’est une femme frêle dont le dos ploie sous l’averse. Ses coudes reposent sur ses genoux, ses mains croisées entre ses cuisses. Des cheveux très noirs encadrent son visage, découpés en mèches longues par l’eau qui ruisselle. La pluie macule de traînées sombre la pureté de sa robe longue, gorgée d’eau, plaquée lourdement contre son corps mince. Sa peau, d’une pâleur lumineuse, éclipse la blancheur du vêtement. De minces filets liquident parcourent ses bras nus, rebondissent dans la saignée du coude, se précipitent vers les mains inertes, croisées entre ses cuisses, dégouttent en cascade vers le sol. Ses pieds disparaissent dans la flaque qui noie le sol, immergés jusqu’aux chevilles dans la boue dorée. Son corps se pare d’un mouvant linceul d’eau. Tout en elle évoque l’abattement, la triste résignation. Elle est pâle, immobile, l’eau glisse partout contre elle, se perd dans les plis de sa robe, s’attarde sur le tissu tendu entre ses cuisses, ruisselle d’elle toute entière. C’est une noyée. Elle est liquide.
Je la contemple. J’oublie tout. Elle prend toute la place. J’oublie le martèlement des gouttes, le goût salé de la pluie, l’obscurité des arbres. Il n’y a qu’elle, prostrée sur son banc, en proie à une peine immense. Aller vers elle, la consoler. Non. Je crains de me révéler, de briser le charme parfait de la situation. Je ne veux pas, d’un geste vulgaire, interrompre l’enchantement, effacer, peut-être, cette délicieuse chimère. Alors je reste sur mon banc. Je ne sais combien de temps je passe à observer l’eau qui ruisselle sur la peau translucide, qui coule de ses cheveux noirs. Les heures sont suspendues, il n’y a que la pluie, qu’une lumière anémique, qu’une journée figée dans une longue averse. Il n’y a qu’elle, fragile, engloutie par le chagrin, n’exprimant rien qu’une lassitude douloureuse. Soudain, un mouvement. Elle redresse la tête. Ses cheveux tombent, ruisselants, encadrent son visage délicat. Elle pose sur moi ses yeux céruléens, étincelles d’azur qui transpercent les ténèbres. La pluie tombe. Je me noie. D’un mouvement souple, elle se lève et se détourne lentement. Ses yeux quittent les miens, me laissent pantelant, submergé de douleur. Ses pieds nus glissent dans l’eau sans troubler la surface fangeuse. Je voudrais la retenir. Elle s’éloigne, infiniment gracieuse, chacun de ses gestes d’une parfaite fluidité. Je suis paralysé. L’écran de pluie brouille sa silhouette, elle disparaît, se fond dans l’ondée. La magie est rompue, la stupeur abolie. Je me lève précipitamment, m’élance sur le chemin qu’elle a emprunté. Ma course soulève de grandes éclaboussures. Je cours sur le sentier qui l’a engloutie quelques secondes à peine arrive sur la berge. De sinistres constructions me saluent sur la rive opposée. Elle est partie. La pluie se fait parcimonieuse maintenant, ce ne sont plus que de fines gouttelettes qui fouettent mon visage. Je scrute, hagard, l’horizon bétonné, hagard. Ce retour brutal retour au monde m’abat. L’illusion est déchirée, mise en pièces. Il n’y a pas eu d’instant de grâce, d’apparition sublime. Rien que mes pauvres délires. Rien que les symptômes de ma solitude. Beauté surnaturelle, yeux d’azur brillants, demoiselle en détresse. Conneries. Machinalement, je reviens sur mes pas. Le cadre de mon hallucination me donne envie de pleurer. Sol bourbeux, bancs délabrés, arbres mourants. Pas exactement le décor propice aux rencontres magiques. C’est plutôt le reflet fidèle des villes : la crasse, le délabrement, la mort. Mon isolement m’afflige, m’égare, me dupe. La laideur devient beauté, l’irréel s’incarne. Je fuis aussi vite que je peux marcher, troublé par l’intensité de mes fantasmes. Sur le chemin du retour, je suis poursuivi par ces grands yeux bleus, ces yeux qui m’en rappellent douloureusement d’autres. Des yeux qui croisaient les miens dans ces rues que je parcours seul, qui portaient sur moi un regard que je ne reverrai jamais. Des yeux que je préférerais oublier mais dont j’ai peur de ne pas me souvenir.
Je rentre chez moi, ôte mes vêtements ruinés, me sèche. La pluie cesse doucement de tomber, la lumière faiblit. Il fera bientôt nuit. Je mange un peu, prends un livre, l’ouvre, le ferme, le jette au loin. J’allume le portable, tape quelques mots, les efface, éteins le portable. Je n’ai la tête à rien, hormis des introspections malheureuses. Autant dormir, oublier quelques temps mes turpitudes futiles, laisser reposer cette petite tête tourmentée. Demain ça ira mieux. Peut-être.
Il fait beau aujourd’hui. Un soleil vif pénètre l’appartement. Dehors, les traces du déluge s’évaporent lentement. Je ferme les volets. Je dois écrire cette nouvelle. Je ne veux pas laisser encore passer une date-butoir sans rien soumettre. J’ai besoin de me vider la tête, pourquoi ne pas écrire ? Être productif ne peut pas nuire. J’écris, j’efface, je corrige, j’imprime, j’annote, je rature. C’est mauvais. C’est toujours mauvais. Entre mon esprit et l’écran, un espace que les mots ne peuvent apparemment pas franchir. Les idées restent dans ma tête, sublimes. À l’écran gesticulent leurs grossières représentations, caricatures hideuses. C’est extrêmement frustrant. Avoir en soi des choses que l’on croit belles et ne pouvoir les exprimer sans qu’elles paraissent gauches, idiotes, banales. Incapable de produire quelque chose qui ne soit pas, au mieux, lamentable. Je m’obstine néanmoins. À force d’écrire, il sortira bien quelque chose de valable. Si ce n’est un effet de mon talent, c’en sera un des probabilités. Je me cloître chez moi. Pas de distraction externe. Je vais achever ce texte aujourd’hui, le corriger demain, envoyer la version définitive après-demain. Simple, clair, précis. Je ne sors pas de cet appartement avant d’avoir fini. L’écran occupe toute mon attention. J’essaie de purger mon esprit des pensées parasites. Et j’écris, j’efface, je corrige, j’imprime, j’annote, je rature. La petite horloge de l’ordinateur marque le passage du temps, m’informe que bientôt, il fera nuit de nouveau, que la journée a fui, perdue dans le noir à torturer le clavier. Je suis las. Les mots s’entortillent sur l’écran, dans ma tête. Je tape encore quelques lignes dénuées de sens, les efface aussitôt. J’éteins tout. Je me couche. Dans l’espace étrange qu’investit l’esprit avant de sombrer, j’entends des voix qui m’appellent. J’entends sa voix qui m’appelle. Ça fait trop mal, alors je sombre.
Je me réveille en sursaut. Un grondement résonne au dehors, relief de l’explosion de tonnerre qui m’a tiré de mon sommeil. J’ouvre le volet pour observer l’orage. J’aime les orages, les illuminations violettes qui découpent les nuages dans le ciel nocturne. Les rues sont désertes. Il doit être tard j’imagine. Les halos orange des lampadaires soulignent d’ombre les reliefs des façades, les profondeurs des ruelles. Tout cela confère à la scène une allure artificielle. Un éclair puissant noie les ombres un instant. Immédiatement retentit un vacarme assourdissant, comme une déchirure monstrueuse. Alors que le tonnerre roule encore, une brise légère apporte l’odeur de la pluie. Bientôt, on n’entend plus que le murmure de sa chute sur les toits, les fenêtres, le sol. Une flaque se forme à mes pieds, sous la fenêtre ouverte d’où j’admire l’orage. Je ressens un puissant besoin de sortir, un désir douloureux qui fouaille mon ventre. Machinalement, je m’habille. Je sais qu’elle est là-bas sur son banc, je sais qu’elle pleure seule sous la pluie. Je veux la voir encore, je veux m’assurer qu’elle est réelle, qu’elle n’est pas le produit d’un esprit malade. C’est insensé. Personne ne s’assoit sous la pluie pendant les nuits d’orage, perdu au fond d’un parc. Pourtant je marche sous l’averse, déjà trempé, je marche vers les berges de bétons, vers l’ile au milieu de la rivière, vers la place inondée où elle trempe ses pieds nus dans une flaque de boue. Je traverse le pont qui enjambe la rivière bouillonnante, je croise les bureaux morts, vides d’employés, j’arpente les venelles pavées envahies de ruisseaux, je dépasse les commerces brillants, je remonte les allées cimentées. La pluie m’accompagne partout, monstrueusement bruyante dans le silence nocturne. Sa rumeur ne cède que devant les grondements du ciel que transpercent encore quelques éclairs coruscants. Me voilà engagé dans l’ample courbe qui longe la rivière noire, auprès des bateaux misérables qui se remplissent doucement de pluie. L’île fait une tâche sombre sur l’obscurité du fleuve. Le petit pont luit doucement sous le sodium orange d’un lampadaire. Ma main agrippe sur la balustrade rouillée. Des écailles de métal s’effritent contre ma paume. La pluie murmure qu’elle est là, sur le banc, comme la dernière fois et cette assurance m’apaise. Je traverse le pont, délaissant les façades jaunies pour l’obscurité de l’île, le couvert de ses branches, la boue de ses sentiers. Je m’avance entre les arbres noirs, tâchant de ne pas m’éloigner du sentier par mégarde. Ma progression est lente, je ne vois rien devant moi. Mes pieds s’enfoncent dans la terre spongieuse, creusent des dépressions aussitôt inondées. Au-dessus de moi, les nuages lourds reflètent la lumière rougeâtre que sécrètent les villes, sang caillé entre les cimes. Le ciel se hérisse sporadiquement d’éclairs qui révèlent un instant le tracé du sentier. Le chemin semble interminable, il s’étire malicieusement, excitant mon impatience, nourrissant mon appréhension. J’y suis maintenant, je distingue une large trouée entre les branches suffisante pour que l’orange du ciel s’infiltre jusqu’au sol, révèle les bancs délabrés. Mon cœur s’emballe et dans mon ventre, cette douleur familière, affreuse, de désir plein de crainte. Je fixe mes pas, évite délibérément de balayer la scène des yeux. Je me concentre sur le sol mou, sur le bruit du vent, les rumeurs de l’orage. J’avance. Je heurte un banc. J’y suis. Je m’accroche désespérément au bois pourri, comme ivre. Je m’assois enfin, fixant toujours mes pieds trempés. Je lève doucement la tête. Elle est en face de moi.
Une lueur faible émane d’elle. Elle se tient droite sous la pluie battante, ses jambes jointes, pieds dans la boue, ses mains fines posées sur ses cuisses. Elle porte une longue robe lunaire, de la teinte de sa peau, collée à son corps menu par l’averse, maculée de langues noirâtres. Ses cheveux coulent en mèches épaisses et sombres sur ses épaules nues. Une mèche barre son visage, contourne un œil, suit l’aile du nez, court sur les lèvres pâles. Il émane d’elle une douceur languide. Mais ses yeux me fixent avec fureur. L’iris, presque violet, flamboie, lance vers moi des éclairs bien plus redoutables que ceux qui embrasent le ciel. Nul rictus haineux ne contracte son visage délicat, nulle crispation ne plisse ses paupières transparentes, nulle pourpre n’enflamme la porcelaine de ses joues. Cependant, ses yeux immenses recèlent une colère lourde, palpable. Elle me regarde intensément et à travers moi ce sont mes semblables qu’elle condamne, ceux qui l’ont blessé cruellement. Elle me regarde et je lis les griefs dans ses prunelles ardentes. Ce sont l’amour déçu, la confiance trahie, la dignité souillée. Ce sont des promesses brisées, des espoirs saccagés, des serments violés. Je sens l’affection immense qui tempère sa violence, qui transforme en colère une émotion plus forte, proche de la haine absolue. Cette retenue est terrible tant on sait que l’objet de cette colère ne mérite pas la moindre excuse, pas la plus petite once de compassion. Impossible d’atténuer sa culpabilité, il sait les conséquences de ses actes, il n’ignore pas la blesser. I compte sur sa nature généreuse pour excuser ses écarts, il abuse de sa patience, de son amour. Elle perd la lutte contre ses émotions, elle souffre, elle déteste, elle pardonne, elle aime. Pour l’heure sa colère est souveraine, mais déjà, imperceptiblement, sa fureur s’apaise, son regard s’adoucit. Il ne restera bientôt plus que la tristesse, l’atroce peine causée par la trahison, sans le feu de la haine pour cautériser la plaie. Elle voit à travers moi, elle s’émeut, elle se calme. L’orage cesse et ses yeux sont azur. L’eau ruisselle sur son visage, pluie mêlée de larmes. Elle ne peut détester, pas plus qu’abandonner. Ce serait contre-nature. Elle est la purification, le pardon, l’indulgence. Elle oublie les outrages, chérit les beaux moments. Elle espère de meilleurs lendemains, sans tromperie, sans parjure. Elle me désespère. Je veux me lever, l’aborder, lui expliquer que non, rien ne changera jamais, qu’on ne peut réparer ce qui a éclaté, qu’on ne perd pas sa vie à rêver autrefois. Je suis paralysé, perdu dans ce regard qui m’ôte la volonté, sondant ces yeux changeants, condamné à prier. Pars, oublie le passé, assez de secondes chances, assez d’abnégation. Aucun souvenir tendre ne justifie tes peines. Je murmure ces mots, ils se noient dans des coulées d’eau froide. Elle rayonne moins maintenant, sa colère s’est enfuie. Elle s’affaisse peut-être, vidée par son émoi. Son corps ne reflète plus qu’un navrement infini. Son regard quitte le mien, se perd dans les cieux. Sa main délicate se porte à son front, elle écarte la mèche humide qui lui barre le visage. L’eau cascade de son menton vers sa gorge, de sa main à son bras, de son coude à ses cuisses. Elle se lève souplement et emprunte le chemin qui s’ouvre derrière son banc. Je la regarde partir sans esquisser un geste, sans prononcer un mot. Sa silhouette blanche tachée de noir se dilue lentement dans les gouttes de pluie, sans un regard pour moi. Me voilà encore seul, sous un ciel sanglant. L’orage est loin maintenant. La pluie se fait hésitante, parcimonieuse, inexistante. Je rentre chez moi.
Je suis allongé par terre, dans l’obscurité. Je gis dans la mare puante suintant de mes vêtements. Je flotte dans une semi-conscience fiévreuse, entre veille et sommeil.
La mer écrase mon château de sable, un ami s’en va, je titube dans une ruelle, trempé par la pluie, chansons dans un appartement brillant, j’appelle le roi de cœur, des bouteilles vides dans un carton, assis sur un banc, j’embrasse Dulcinée, des yeux furieux me fixent, je m’enfonce dans la boue, réunis chez moi, on m’offre un cadeau, l’eau s’écoule dans une tente, le rugissement des vagues, le grondement du tonnerre, des avenues grises, promenade nocturne sur une digue, accompagné, seul, des tournées de bière, des rires, des amis qui s’étreignent, des amis qui s’en vont, périple automobile, autres villes, autres appartements, routes luisantes d’eau, caniveaux gargouillant, égouts inondés, ensemble à l’université, ensemble au restaurant, ensemble dans les rues, départs, déménagements, accolades, jeux vidéo, nuits blanches, rires, pique-niques, trinquant, tintements, page blanche, fenêtre striée d’eau, ciel plombé, promenades solitaires, gorge nouée, yeux douloureux, abattement, cheveux dégouttant, conversations téléphoniques, journées perdues à lire, étreintes, manque. Souvenirs, hallucinations. Ils sont partis, vivent ailleurs, nouent d’autres amitiés, rient dans d’autres lieux. Je suis resté, coincé dans ces rues grises, coincé dans ces années. Je n’ai pas de projets, mes amitiés s’étiolent. Bientôt, je serai vide, sans objectif, sans avenir. Il n’y aura que les évocations douloureuses de discussions passées, de rires perdus, d’étreintes fantomatiques. Je ne veux pas cela, je ne veux pas d’une vie de regrets, de nostalgie douce-amère. Il n’y a pas d’âge d’or, rien n’est irremplaçable. Je veux encore des rires, encore de la folie, je veux des discussions sans la moindre importance, des plaisanteries idiotes, magnifiées par la fatigue. Je veux renouer des liens, redécouvrir des gens, apprécier leur valeur, oublier leurs défauts. Je veux retrouver le plaisir lancinant des amours naissantes, jouir du doute, cultiver plaisamment l’ambiguïté de la séduction, atteindre l’aube dans des bras caressants. Trop de souvenirs hantent mes horizons quotidiens, trop d’émotions marquent les murs de cet appartement, de cette ville. Je dois laisser cela derrière moi, repartir à zéro, ailleurs, comme les autres, découvrir d’autres lieux, arpenter d’autres rues, rencontrer d’autres gens. Je vais partir. Emballer mes affaires. Partir. N’importe où. Changer de vie, suivre de nouvelles routes, hanter de nouvelles villes. Me mêler aux foules idiotes des centres-villes, aux faunes bizarres des bars. Comprendre l’essence des lieux, le labyrinthe des ruelles, les glyphes des murs. Renaître ailleurs, débarrassé des scories de mon ancienne vie. Être neuf.
Je m’assois dans l’eau croupie et contemple l’obscurité. C’est la nuit je crois. Je ne sais plus. Je me lève, ôte mes vêtements puants. L’humidité a flétri ma peau. Par endroits, elle se détache, cède, s’ouvre. J’allume l’ordinateur, lance le traitement de texte, fixe la page blanche. J’écris. J’écris les souvenirs qui m’attachent à cette ville, j’écris pourquoi je l’aime et pourquoi je la quitte. Je suis en mode automatique, les mots s’alignent sans que j’y pense. Graphorrhée, ma pensée se matérialise à l’écran, brute, sans amphigourismes. Ma tête se vide, son contenu se déverse en caractères électroniques qui s’agglomèrent en mots, phrases, paragraphes, sans hésitation. Le flot se tarit, les dernières lettres plongent vers l’écran, une à une et l’ultime point clôt le tout. Je n’efface rien, je ne corrige pas, j’imprime, je glisse dans une enveloppe, j’adresse, je timbre. Voilà. Je suis libre.
Je peux préparer mon départ, vider les placards, remplir les cartons. Ce ne sera pas bien long, je ne possède pas grand-chose. Les meubles sont loués, les placards presque vides. On ne croirait pas que je vis ici depuis des années. Malgré mon attachement maladif à cette ville, on dirait que je ne m’y suis jamais posé. Il n’y a rien ici de cher, d’unique. Il n’y a que les atours génériques de la vie moderne. Quelques livres, quelques disques, quelque vaisselle, quelques vêtements. Ce pourrait être l’appartement de n’importe qui. Triste constat, craindre de partir sans être jamais arrivé. Voilà, une heure à peine. La dernière fois, cela avait pris plus de temps. Mais aujourd’hui je suis résolu. Je ne resterai pas entre les cartons pleins, incapable de franchir la porte. Pas cette fois. Je peux tourner la page, dire adieu à cette période de ma vie. Les souvenirs ne me retiendront pas. Pas cette fois. Je peux partir. Je peux changer. D’abord, dormir.
Yeux d’azur noyés, immensités houleuses, longs cheveux noirs flottants, opacité glauque, robe souillée ondulant dans le courant, apesanteur, membres translucides, délicats, mouvements ondoyants.
Je m’éveille. Une odeur humide imprègne l’air. Une mousson désespérée noie la ville. J’entends la plainte du vent, les bourrasques qui hurlent autour des bâtiments, fauchent la pluie lourde dans sa chute, la fracassent contre les façades détrempées. J’entends l’eau qui tombe du ciel, qui glisse sur les toits couverts de suie, dévale les gouttières métalliques, bouillonne dans les caniveaux, cascade dans des égouts qui déborderont bientôt. J’entends son appel.
Des trombes furieuses occupent tout l’espace. Instantanément, la pluie me submerge, son fracas m’assourdit, sa densité m’aveugle. Mes pieds brassent l’eau qui engloutit les trottoirs, les routes. Ma pénible progression soulève des gerbes noires aussitôt écrasées par l’impitoyable déluge. J’atteins le pont duquel se jettent des centaines de cascades. La rivière s’élève démesurément. Ses flancs débordent sur les quais de pierre, lèchent presque la rue. Son courant puissant charrie des débris nombreux, ordures dansant à la surface des eaux bourbeuses. Je poursuis mon périple, affronte les torrents qui giclent des gouttières, explosent contre les obstacles, envahissent les rues. Par endroit, leur virulence accrue me déséquilibre, me jette dans leurs cours sauvages, à peine plus humides que l’air saturé de pluie. Je patauge jusqu’au centre ville. Le dédale familier est inondé, le pavé disparaît sous des flots écumeux encombrés de déchets. L’éclairage défaille par endroit, plongeant dans la noirceur plusieurs artères, lampadaires morts et boutiques aveugles. Je brave les ombres et remonte les rues d’Atlantis, à la rencontre de l’île perdue dans l’eau, de celle qui exige ma présence. L’avenue large qui m’entraîne vers la rivière se perd dans les masses aqueuses jaillies des nuages. L’univers est gris. Des immeubles de béton sombre se confondent avec les nuées, forment une haie compacte de part et d’autre. Il n’y a plus d’horizon, juste un mur mouvant qui à tout moment se jette sur moi, m’éclabousse avec force. Ma vision se brouille sous l’assaut, j’avance en protégeant mes yeux de la main. J’approche du point de résurgence de la rivière. Elle avale les pavés gris. La frontière entre la chaussée et le lit du cours d’eau s’efface. Je m’écarte au jugé, craignant d’être plongé par mégarde dans les eaux troubles. Des formes sombres émergent de la pluie, des embarcations inondées, mourantes. Les tentacules aquatiques les étreignent dangereusement, les attirent vers les profondeurs agités où la rivière les digérera. Ployant sous l’averse, j’entrevois bientôt des arbres dont les branches pesantes découpent des formes spectrales contre les nuages lourds. Les branchages tressautent, comme agités par un vent vif. C’est la pluie qui gifle violemment le bois détrempé, qui brisent les plus minces branches de sa force inlassable. C’est la pluie qui inflige à la ville, bâtiments, rues, arbres, humains une bastonnade impitoyable, lassée, pourrait-on croire, de leur présence, décidée à les effacer sous la surface unie de l’eau grise. Et tous souffrent de cette condamnation, les bâtisses rongées par les infiltrations, les allées aspergées des produits de l’égout, les racines pourrissant sous des mares stagnantes et moi, étourdi par l’averse, aveugle, sourd, titubant, me hâtant sans succès vers un improbable rendez-vous. Un dernier rendez-vous. Une ultime rencontre avant de laisser cet endroit, un dernier souvenir agréable à emporter, l’image d’une perfection irréelle, rencontrée à la faveur des eaux. La rivière lèche mes pieds et je m’écarte encore, montant sur la ligne de tram qui suit la courbe familière. L’arche du ponton se matérialise près de moi. L’eau s’approprie le tablier et s’enroule autour des balustres branlants. Je descends sur la berge pour accéder au pont. Mes jambes sont immergées. Je tends un bras fébrile vers la rambarde, à la recherche de stabilité. Je sens la pression insistante autour de mes chevilles, le courant m’intime de le suivre à la dérive, vers l’horizon aveugle, vers les fonds meurtriers. Ma main accroche la rambarde. Mes vêtements ondulent autour de moi, battant mon ventre, mes cuisses. Je me tire vers l’apex du pont, me redresse. L’eau court à mes chevilles, son exhortation devient proposition timide. Une chaîne interdit désormais l’accès à l’île, arguant de la nature préoccupante de ses abords. J’enjambe cette piètre barrière et m’avance vers l’île menacée. Ses berges disparaissent sous l’onde avide qui engloutit les arbres, les buissons. Les troncs luisants fendent la surface, indiquant les contours occultés. Mes mollets, mes genoux, mes cuisses replongent lentement dans le traître liquide. Je lutte quelques secondes contre la pression de l’eau et m’élève lentement vers le centre de l’île. Le niveau baisse à mesure que je m’enfonce dans l’ombre mouillée. Le monstrueux déluge absorbe toute lumière, du ciel ne filtre pas la moindre lueur et rapidement, je plonge dans une obscurité totale. Ma mémoire me guide le long du chemin inondé. Ma vision s’habitue à l’absence de lumière, je distingue des nuances, les silhouettes spectrales des troncs indiquent péniblement les contours du sentier. La pluie implacable hache les feuilles, l’air résonne d’un froissement torturé soutenu par les explosions de bombes pilonnant les flaques profondes où se noient mes pas. Il ne me semble plus tant marcher que nager, l’eau ruisselle dans mes yeux, s’infiltre dans mon nez, ma bouche, dépose partout un film gras, une saveur de rouille. J’affronte le liquide hostile, je vogue vers la petite place perdue dans les profondeurs de l’île. Le sol noyé s’oppose à ma progression, se dérobe, m’agrippe. Je chute, m’enfonce mollement dans le limon visqueux, me relève, continue. Le chemin s’allonge sans fin, je ne pense qu’à avancer, encore, l’objectif même semble oublié, il n’y a que la lutte contre mes adversaires, une mousson sauvage, une route traître, une obscurité froide. Elles ne m’arrêteront pas. Déjà leur animosité faiblit, vaincue par mon obstination. Les ténèbres s’éclaircissent, mes pas s’affermissent, je redresse ma tête courbée par le déluge. Une lueur blafarde tremblote devant moi, diffuse un halo doux à travers la pluie noire. Quelques bancs se dessinent dans la lumière diffuse. Sur l’un d’eux elle sanglote éperdument.
Sur ses mains glissent ses cheveux sombres, qui s’enroulent entre ses doigts d’albâtre. Une robe d’émeraude épouse son dos courbé, secoué par les pleurs. Ses bras s’ornent de millions de larmes qui glissent lentement vers le bassin dans lequel plongent ses jambes. L’eau sur elle crépite doucement, pétille sur sa peau, induit un scintillement fascinant, une nitescence glauque. Son allure féérique contraste avec la peine inhumaine qui fait couler ses larmes. Je fixe l’apparition, paralysé par ce chagrin immense impossible à apaiser. Le sentiment d’impuissance est intolérable. Je voudrais aller vers elle, la consoler, bannir la tristesse de ses yeux étranges, effacer les tourments qui embrument son visage. Je fais un pas vers elle. Je voudrais un instant jouer un rôle dans sa vie, qu’elle se rappelle toujours comme un soir de pluie un homme s’est approché, l’a écouté pleurer, a prononcé des mots qui ont calmé son cœur, a souri, est parti, la laissant soulagée. L’eau remue à mes pieds. Je ne peux ignorer cet horrible chagrin, cette douleur atroce qui l’amène chaque orage pleurer seule sur ce banc au milieu de la nuit. Un autre pas encore. Son charme délicat ajoute à l’odieux et l’on voudrait savoir telle grâce radieuse et non pas ramassée, assommée par la pluie, dans des parcs lugubres, ravagée de soucis. J’avance maintenant sans plus d’hésitation, toute idée écartée par mes résolutions : ne pas la laisser seule, lui dire ma sympathie. Mes pas encouragés par mon embrasement me portent à ses côtés, près du banc dégradé. Son charme est décuplé par la proximité. Son vêtement moiré est changeant sous la pluie, maintenant aigue-marine parsemé de souillures qui semblent ondoyer, abjectes arabesques, s’étirer, se gonfler, envahir le tissu. Mes yeux fuient ces poisons et s’égarent dans la courbe délicate de son cou, glissent le long de l’épaule nue dont la pâleur phosphorescente me trouble profondément. Je voudrais la toucher, vérifier la réalité de cette chair parfaite qu’il me semble rêver. J’amorce un mouvement, réprimé timidement, mon bras s’élève, hésite, retombe lentement. Je me sens absorbé par la même torpeur qui me prît par deux fois contemplant sa beauté. Elle sanglote toujours. Je me force à l’action, déplace mon corps gourd, m’assois à son côté sur le bois pourri. Elle se redresse, peut-être surprise de cette intrusion, j’imagine son visage tourné de mon côté, des saphirs étincelants braqués sur ma personne. Je fixe mon regard sur les ténèbres engorgées, feins d’ignorer sa présence. Je vide mon esprit des pensées qui m’agitent, éradique les traces d’hésitation tremblante. À ce prix seulement j’oserai commettre le sacrilège que je prémédite. Il n’y a que les ombres et une âme éplorée. Ma main quitte mon flanc et calmement s’élance, se pose sur la sienne, l’enserre. Sa main est douce, ruisselante, glacée. Elle ne réagit pas. Cet instant s’éternise, délicieux, angoissant. Chaque seconde égrenée me fait craindre sa fuite. Soupçonnant que l’étreinte puisse bientôt finir, je commence à parler, fixant toujours la nuit. Je lui dis le bonheur de l’avoir rencontrée, la fascination qu’elle provoque, l’émotion qu’elle engendre. Je raconte mes périples pour répondre à l’appel et venir la trouver sur cette île inondée. Je dévoile ma colère de la savoir triste, d’être le témoin muet de ses larmes. Je sais les trahisons, je sais les regrets. Je connais les blessures dont elle souffre à présent, les longues écorchures laissées par ceux qu’on aime, saignantes, inguérissables. Les pleurs qu’elle verse sur ces moments perdus sont inutiles, dangereux, ils épuisent ses forces, l’empêchent de progresser. Pleurer un peu bien sûr, mais oublier sous peu les cruels reliefs de la confiance brisée, passer à autre chose, ne plus se retourner. Renoncer à ce qu’on a tant chéri, effacer les ravages de l’échec subi, repartir à zéro, reconstruire de rien en apprenant de ses erreurs. Cela la guérira de son humeur navrée, lui offrira les joies d’opportunités nouvelles. On avance entre les ruines du passé, mises à terre par nos propres soins. Sa main frémit dans la mienne, caresse ma paume. Je me tais à présent et je reste immobile, ne sachant quoi attendre. Je voudrais prolonger ce moment pour toujours, assis côte à côte, flottant dans les mêmes eaux violentes crachées par le ciel noir. C’est bien sur impossible. Avec appréhension, je me tourne vers elle. Ses yeux bleus m’examinent. Je soutiens ce regard fantastique, m’émerveille des coloris subtils des iris pleins qu’aucune pupille ne mange. Leur teinte varie constamment, étincelle un instant, s’assombrit, miroite, change encore. Sa main recule doucement contre le bois du banc. Elle se lève, fluide, l’eau cascade de son corps délié. J’accompagne son mouvement dans l’espoir de la retenir quelques instants. Sa main coule entre mes doigts et déjà, elle s’éloigne. Sa silhouette s’estompe, elle se dissout dans la pluie. Je la regarde partir pour la dernière fois. Soudain elle s’interrompt, se retourne vers moi. Son visage exprime une triste résolution. Elle m’adresse un pâle sourire, un vague signe de la main. Elle se détourne, s’immerge dans les eaux, disparaît. Je cours à sa poursuite sachant l’inutilité de mon geste. Je me retrouve sur la berge, pataugeant dans un courant glacé. Elle n’est plus là. Je fuis l’île désertée, franchis le ponton condamné, cours dans les rues noyées. Je ne la reverrai pas. J’ai brisé la magie. Je veux juste rentrer, l’oublier. Alors que je traverse le pont qui surplombe la rivière en crue, la pluie s’intensifie, vient gonfler le flot sombre qui gronde sous mes pas, prêt à engloutir la ville, à effacer mon existence.
La pluie ne cessera pas.
|
|
Dernière mise à jour par : Jormugaund le 16/01/09 20:47
|
|
|



|

|
 Cachée Cachée

|
|
|