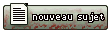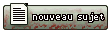.

-= Chaos Servants =-
Inscription le 11-01-03
Messages : 1232
 Age : 42 ans Age : 42 ans
Lieu de résidence :
|

|
|
|
|
The Stooges a été posté le : 22/05/07 14:00
|

Dans l’Amérique hippie toujours aussi puritaine, le rêve américain commençait à dangereusement se fissurer à la fin des 60’s. Dans la rouille et le béton des grandes villes de l’est, le rock s’industrialise. Le Velvet Underground commence à éclairer la face sombre du rock, les Doors apportent une expérience violente et provocante à un plus grand public… et à la fin de la décennie, Detroit est mûr pour les white panthers du MC5 et le gang des Stooges. A l’époque, James Osterberg, enfant de la classe moyenne passé par l’université – mais tout de même rejeton white trash élevé dans une caravane – travail chez un petit disquaire d’Anne Arbor dans le Michigan. Cité industrielle, banlieue de la capitale automobile du monde, la ville n’a pas grand chose à lui offrir. Ni à lui, ni aux quelques voyous dont il fait la connaissance, comme les frères Asheton. Osterberg est amateur de rock, mais aussi de blues et de jazz, il se passionne pour les Doors et James Brown, et pratique la batterie depuis ses années de lycée, au sein des Iguanas, ou plus professionnellement pour accompagner les blues-men noirs de Detroit. Il fait ses classe, se déniaise au contacte de ces gens, et acquière finalement le pseudonyme d’Iggy Pop. Décidé à aller de l’avant, il est prêt à fonder son propre groupe pour poursuivre sa voie.
Rapidement débarrassés de leurs premières expérimentations sonores (instruments faits mains, enregistrement d’un aspirateur, etc.) et lestés du terme Psychedelic qui précédait leur nom dans les premières heures, les Stooges s’attribuent le rôle de trublions. Leur patronyme, ils le tiennent d’un groupe de comiques, les Three Stooges, gaudrioleurs parfois traduits en français sous le terme de Charlots. Mais cette vision, c’est Iggy qui la possède. Les autres restent des voyous. Des punks, en argot américain. Il lui faudra deux ans d’encouragements et de travail pour faire de Ron et Scott Asheton et du bassiste Dave Alexender des musiciens capables. Deux années de répétitions au court desquelles les Stooges se forgent un son et une personnalité, et imaginent quelques riffs qui serviront de base aux premières chansons d’Iggy Pop. Alors qu’il s’appelait encore Osterberg, il s’était déjà essayé à la poésie. Avec son groupe, il peaufinera son style dans le minimalisme : c’est l’influence du comique télévisuel Suppy Sales qu’il citera plus tard pour expliquer ce choix avec sa phrase « envoyez moi vos lettres, mais pas plus de vingt-cinq mots ! » Plus intellectuel qu’il n’y parait, Iggy Pop fait ainsi le choix réfléchi de ne pas reproduire la musique intello de Lou Reed. Ses textes se rapproche du beat originel du rock, et avec ses moins de vingt-cinq mots il colle sa voix sur les riffs binaires de Ron : « No fun, my babe, no fun ! No fun to be alone. Walking by myself. No fun to be alone. In love with nobody else. » Quinze mots, tout au plus, et la moitié d’une chanson. La poésie rock industrielle des années 70 vient d’être inventée. Un air à la Johnny Cash (I Walk The Line), un pont stonien et quelques touches du Velvet, le tout violemment brassé, et No Fun devient un hymne d’un genre nouveau.
En 1968, les Stooges jouent autant que possible dans le cercle restreint de la région de Detroit. Ils se font une réputation sulfureuse, et Iggy devient l’attraction détestée du rock local. Invectivant son public, se roulant sur scène, il pousse la violence à un paroxysme alors inconnu, et bien moins affecté que les provocations d’un Jim Morrison. Ca ne se termine pas toujours bien, parfois avec du sang, occasionnellement en garde à vue, mais la chose la plus effrayante dans cette spirale, c’est qu’elle semble toute naturelle à Iggy et ses sbires. Autre riff, autre chef d’œuvre, il gueule à qui veut l’entendre qu’il veut être un chien. « I wanna be your dog ! » L’Amérique ne comprend pas d’où peut venir toute cette hargne et ce rejet d’une personnalité saine. Mais Danny Fields croit comprendre, prend le groupe sous son aile pour le label Elektra (qui signe le MC5 en même temps… deux contrats qui donneront des cheveux blancs précoces aux cadres de la boite), et l’enferme en studio en compagnie de l’ex-Velvet John Cale. Diable dans la boite, quoi qu’il fasse, Iggy continu de pousser le bouchon plus loin. Quelque part, il devait se dire « voyons voir où et quand ça s’arrêtera ? »
John Cale est trop intellectuel, trop rompu aux règles de la musique. Sa provocation cérébrale ne s’accorde pas à la folie physique des Stooges. Son influence sur ce premier album sera donc limitée, et Iggy mènera sa barque. Pas toujours là où il l’entend. Le groupe entre en studio peu préparé, il n’est encore qu’un phénomène de foire. Les quelques chansons à son actif ne suffisent pas à remplir les deux faces d’un L.P., alors il faut baratiner et improviser en catastrophe de quoi combler le manque. C’est comme ça qu’on se retrouve avec les dix minutes de We Will Fall, jam plus psychédélique que ne le seront jamais les Stooges, en même temps qu’une relecture médiocre des passages planants du Velvet. Avec quelques touches sonores reconnaissables de John Cale, mais pas le génie du feedback de Sister Ray. On peut supposer que Ann est le fruit de la même nécessité. Pas un ratage complet, mais une touche planante, un écho dans la voix, une guitare sous reverb et une compensation par la production de l’absence de folie qui trahi le son des Stooges.
Reste six titres à l’album, trois chef d’œuvres et trois bonnes chansons. No Fun et I Wanna Be Your Dog font donc des Stooges des génies, tout comme le 1969 sur lequel Iggy continu d’aborder l’ennui, le désespoir et le pessimisme de sa génération. « Last year I was 21 / I didn’t have a lot of fun / Now I’m gonna be 22 / I say oh my and boo hoo ». Derrière, la rythmique martèle, et Ron Asheton fait du bruit. Leur musique est celle d’un jeune groupe qui vient à peine d’apprendre à jouer, mais qui est guidé par la vision de son leader et joue donc exactement ce qu’il faut. Cette guitare saturée incarne la face cachée de l’Amérique bien plus que le violon du Velvet ou l’harmonica de Dylan. La contestation est ici, et il est dans l’ordre des choses qu’elle fasse des Stooges les parrains du futur mouvement punk. Ils ont été les premiers à travailler comme on le fera en 77.
Peut être moins indispensables, les courts Real Cool Time, Little Doll et Not Right restent de bons rocks, des témoins fidèles de l’esprit des Stooges. Mur sonore, riffs et cris sont au rendez-vous et assurent à ce premier album de ne pas s’écrouler sur sa seconde face. Chantant haut, de tout son coffre, avec sa voix grave, Iggy Pop rend la vitesse et l’énergie mélodiques. Il façonne le son d’un cris au sein de ses couplets. Et il chante surtout les choses qui ne sont pas comme elles devraient être (« Not right ») ou bien simplement le vide, répétant « we will have a real cool time tonight » sans même prendre soin de s’expliquer et en restant bel et bien sur toute la chansons sous la barre des vingt-cinq mots. Brutalement hypnotique, la dualité de ce rock est exprimée par le dédoublement de la guitare entre riffs acérés et volutes mélodiques. Les Stooges offrent au public qui sait les saisir l’expérience de la folie, une transe par le biais de la musique qui dépasse l’entendement et échappe à la compréhension.
--------------------
*** Et c'est ainsi qu'Allah est grand. ***
O.D.ed on life !
|
|



|

|
 Cachée Cachée

|
|

.

-= Chaos Servants =-
Inscription le 11-01-03
Messages : 1232
 Age : 42 ans Age : 42 ans
Lieu de résidence :
|

|
|
|
|
Réponse au Sujet 'The Stooges' a été posté le : 22/05/07 15:26
|

Un an après le premier, voici le second album des Stooges, dernier L.P. du groupe pour le label Elektra qui ne sera pas satisfait du style invendable du groupe. Sous une pochette iconographiant leur musique, dans un rouge entre flammes et sang, et avec un titre en parfaite osmose avec son contenu, Fun House fait entrer les quatre enfants terribles de Ann Arbor dans la légende. Imaginez vous la banlieue de Detroit, des immeubles, des usines, des cartiers résidentiels décrépits. La grande cité dans tout ce qu’elle a de plus désespérant. Au milieu des pavillons tous battis sur les même plans trône une maison plus branlante que toutes les autres. Son jardin n’est sans doute pas entretenu, quelques ordures y traînent très certainement, délaissées par les éboueurs. Vous avez devant vous la Fun House, le quartier général des Stooges. Dedans, l’atmosphère est enfumée, les veines aspirent goulûment les drogues qu’on leur offre, et Iggy Pop imagine le matériel de son premier chef d’œuvre.
Oubliez la production pataude de John Cale, l’ex-Kingsmen Don Gallucci qui officie ici a su capter l’essence des Stooges comme personne d’autre (et certainement mieux que David Bowie trois ans plus tard). Enregistré en une semaine, consacrant chaque journée à un nouveau morceau, Fun House sonne stoogien : live, brut, violent, fou. Le mur sonore est un énorme monolithe d’acier écrasant de tout son poids le silence ambiant. Album le plus assourdissant de l’époque, Fun House est sans comparaison, superlatif, et indescriptible. Sa seule pochette en serait en fait la meilleure critique, la meilleure image. On se répète souvent ces dernières années l’anecdote de Jack White, l’âme des White Stripes qui a redonné à Detroit ses lettres de noblesse rock, découvrant ce terrible L.P. dans une poubelle derrière chez lui, et se laissant envoûter par les Stooges. Cette anecdote, donc l’authenticité ne présente aucune espèce d’intérêt, révèle tout du statu de Fun House dans le paysage rock. C’est un épicentre, un briseur de vies. Cet ado ou un autre, tous ceux qui comme lui sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits en ont été changés. Combien de jeunes groupes de rock ont ils appris à jouer sur ce disque ? Combien d’âmes déçues se sont elles réconfortées en faisant tourner ces sillons sur leur platine ?
Avec le temps, la vieille masure décrépie fut donc classée monument historique par les parangons du rock. Ce foutoir est devenu un myth. Mais bien sûr, parce qu’il s’agit de rock, que la musique parle au corps et déconnecte l’esprit, parce que l’entrée de ce monument est ouverte à tous, Fun House a échappé à la mort et à la poussière des musées. Les flammes de sa pochette ne se sont jamais éteintes. Le sang a continué de couler, et la drogue avec lui.
Bien meilleurs musiciens qu’à leurs débuts, arpentage de scènes et répétitions forcenées aidant, les Stooges sont capables de choses beaucoup plus grandes. Ce son qu’ils ont trouvé, maîtrisé et adopté comme leur propriété exclusive, ils vont maintenant découvrir comment l’exploiter à sa pleine puissance. Ils sont en quelques sortes débarrassés de toutes attaches, débridés. Il n’y a que comme ça qu’un Iggy Pop puisse gueuler son « I feel alright » à pleins poumons sur 1970, par dessus une ligne de basse en forme de grand huit. Du magma sonore s’échappent deux instruments qui rendent Fun House unique : cette basse, mixée en avant et guidant toutes les cavalcades du groupe, et le saxophone de Steve McKay réintroduisant dans le rock des Stooges leur goût premier pour l’expérimentation. Dans la vision d’Iggy Pop, c’est la curiosité à toutes les formes musicales qui apparaît ici. La basse, c’est celle du funk et de la soul, ce rythme légendaire issu du vaudou qu rend les musiques noires si vigoureuses. Le saxophone ténor est noir, lui aussi, il nous vient de Coltrane. Free, libre, son timbre de cuivre apporte une texture sonore originale à la seconde face, les morceaux Fun House et 1970.
Dans les cris, dans le bruit, les Stooges vont aller jusqu’à l’extrémisme. Plus de We Will Fall branlant, mais leur propre équivalent du bruit aberrant et déshumanisé de Sister Ray : L.A. Blues. Cinq minutes mixées à partir d’un jam quatre fois plus long. Un magma de folie pure mêlant les hurlements d’Iggy à ceux des quatre instruments. Tout se mélange pour former le son de la folie. Quand toutes les couleurs sont assemblées, le résultat est le noir. Quand tous les sons sont assemblés, c’est le bruit blanc qui déchire les enceintes. Après sa pochette et son titre, c’est cette profession de foi extrême qui forme le troisième élément descriptif de Fun House. Equivalent sonore des mutilations d’Iggy sur scène, L.A. Blues fait écho au Velvet Underground et annonce Metal Machine Music de Lou Reed. A une plus faible échelle, il fait exploser les limites du rock.
Ce point de chute étant atteint, on peut en revenir à des structures plus pertinentes, ne conservant que la folie nécessaire au génie et à l’inspiration. La violence reste au centre de tout. T.V. Eye impose le riff le plus lourd et tranchant qui soit. Répété, répété, et même repris après un blanc assourdissant en fin de pont. Cris de macaque d’Iggy par dessus ça, psychopathe échappé de la jungle urbaine. La transe vaudou évoquée plus haut devrait ici quitter les musiciens pour s’emparer de leurs auditeurs. Communion via la musique, violence exacerbant les personnalités.
Down On The Street et Loose n’en font pas moins. Iggy hurle et éructe beaucoup, avant de se décider à chanter. Et les Stooges travaillent au plus pur des rocks. Equation parfaite de la section rythmique et de la guitare du riffmeister, celle qui va expliquer à ceux qui n’ont pas compris qu’il est temps d’abandonner tout espoir de consensualité sociale et de commencer, enfin, à sauter partout. « Loose » (à hurler avec autant de « o » que nécessaire), libérez vous, relâchez vous, laissez vous aller. Les tambours martelés par Scott Asheton donnent le rythme, le tempo que le corps humain ne peut pas refréner. Tout cela fini dans le sexe, bien évidemment, comme toujours. Et Iggy de hurler « I stick it deep inside » ou de raconter l’histoire de cette nana qui a « l’œil T.V. » pour lui. Autant de déclinaisons parfaites de I Wanna Be Your Dog, en attendant Penetration.
Plus loin, la transe prend une autre forme. Sombre, malsaine. Réellement effrayante. Dirt. La basse fait trembler les murs de la Fun House qui menace de s’écrouler. Lente, sourde, elle martèle nos tympans sept minutes durant, jusqu’à l’épuisement. Iggy narre les méandres de son âme, salle et déchirée. Brûlant de l’intérieur, très exactement comme il est représenté sur la pochette. C’est une icône du rock, un sain à sa manière. Ce monde de souffrance et de désillusion est transpercé de part en part par le gémissement ardent de la guitare, des cordes tordues jusqu’à extinction de l’ampli lui même. Chaque cris d’Iggy dans l’album nous amène vers un de ces solo de Ron Asheton qui tresse des formes dans les airs alors que son frère Scott et Dave Alexander restent pied à la grosse caisse, lourdement accrochés au plancher des vaches.
Toujours cette basse, toujours ces cris, une batterie martelée, la guitare égrillarde, puis le saxo qui vient compléter Fun House comme une épice exotique. Ce morceau final d’avant le L.A. Blues est le plus jazz et donc le plus débridé. Il s’échappe tel un jam du MC5 période Kick Out The Jams, et forme le pendant vif et sauvage, sans retenue, de la transe de Dirt. Ces deux morceaux sont l’emblème de ce que les Stooges ont fait sur leur second album et qui ne sera plus jamais reproduit. Plus « classique », 1970 envois le riff à cent à l’heure et envoi les Stooges en orbite, géniaux, laissant le saxo le soin d’une envolée lyrique pour un solo vraiment rock.
Utilisation parfaite de chacun des éléments du son unique que les Stooges ont trouvés, Fun House est la drogue des âmes les plus violentes du rock, un exutoire parfait à l’agressivité qui embrouille l’esprit. La maison insalubre, passée au karsher, s’écroule dans un sursaut salvateur pour le rock tout entier. A partir de ça, les 70’s vont peut être pouvoir faire quelque chose de bon, loin du hard-rock et du prog qui n’ébranlent même pas des stades trop grands pour eux. Mais tout ça, bien sur, est plus facile à dire aujourd’hui qu’en 1970. Lassés de ce qu’ils considéraient comme les pitreries d’un trublion sans intérêt, Elektra a lâché l’affaire. La drogue n’aidant pas les choses, Iggy Pop est tombé bien bas, Dave Alexander est mort… Heureusement il y aura Bowie, pour Raw Power, la remise en cause de tout ce qu’a apporté Fun House. Déjà !
--------------------
*** Et c'est ainsi qu'Allah est grand. ***
O.D.ed on life !
|
|



|

|
 Cachée Cachée

|
|

.

-= Chaos Servants =-
Inscription le 11-01-03
Messages : 1232
 Age : 42 ans Age : 42 ans
Lieu de résidence :
|

|
|
|
|
Réponse au Sujet 'The Stooges' a été posté le : 22/05/07 15:28
|

Après deux albums les Stooges sont déjà presque à l’agonie. Le bassiste Dave Alexander est mort, le groupe ne vend rien, ses concerts font scandale, et le public ne suit pas les errements de cet Iggy Pop et de ses voyous de Detroit. Mais Iggy est coriace et va engager le guitariste James Williamson pour redonner un élan à son groupe. L’année 72 se passe entre répétitions et écriture d’un nouvel album, mais rien de sérieux ne se passe pour le concrétiser avant que Tony DeFries et David Bowie ne croisent Iggy à New York et ne le recrute pour enregistrer à Londre. Mais c’est Iggy Pop qui intéresse les deux producteurs, et pas les Stooges, leur enthousiasme se résorbant donc rapidement quand celui-ci impose son collaborateur Williamson, puis les frères Asheton pour la rythmique, en place des musiciens anglais proposés. A partir de là c’est un Iggy jusqu'au-boutiste qui dirigera lui même l’enregistrement de ce qui allait devenir Raw Power.
Quand l’album arrive dans les bacs, ce n’est pourtant pas exactement celui qu’a voulu Iggy Pop. David Bowie qui a travaillé au mixage a plutôt édulcoré le son que l’Iguane aurait souhaité le plus hard possible. Tout n’est cependant pas noir puisqu’en bon amateur de technologie, Bowie trouve quelques idées d’effets sonores, comme un écho artificiel la guitare de "Gimme Danger". En second lieu, la pochette qui orne l’album a été choisie sans consulter le groupe, et déplait à Iggy Pop lorsqu’il la découvre. Pour le coup on remerciera Bowie et DeFries pour leur clairvoyance, tant cette photo teintée de rouge est devenue une véritable icône du rock à travers les décennies suivantes. Iggy Pop racontera plus tard qu’il savait à l’époque que cette musique était trop extrême et ne pourrait pas fonctionner, d’où le "Death Trip" concluant l’album. Effectivement, six mois après la sortie, l’échec de l’album est évident, il est bradé à quelques cents par les disquaires, et les Stooges sont cette fois ci enterrés pour de bon. Quelques nouveaux morceaux seront bien écrit par le tandem Pop/Williamson, mais le quatrième album des Stooges ne verra pas le jour.
Vingt ans plus tard, Raw Power fait l’objet d’un véritable culte. Des générations de rockeurs et de critique rocks ont vécus leurs premiers émois sous les cris furieux d’Iggy, et celui-ci est devenu une légende vivante. Reste que le son de l’album n’est pas à la hauteur de ce qu’il est devenu, et que ce défaut s’est aggravé avec le passage au format cd. A l’époque des remasterisations, Raw Power bénéficiera donc du traitement de force, Iggy se chargeant de diriger un nouveau mixage pour lui rendre la hargne perdue. Le résultat de se travail, sorti en 1997, est devenu la version définitive de Raw Power, éclipsant totalement l’original pour en faire un chef-d’œuvre à la hauteur du son des années 90, celui de Nirvana et consorts. Electrique, sans cesse sur la corde raide, Raw Power est le type même du disque qui fait grésiller les enceintes, fait fondre les amplis, bref, en met plein les oreilles. Les riffs de James Williamson sont plus crachant que jamais, et Iggy hulule comme un possédé… ce qu’il était probablement plus ou moins, soit-dit en passant.
Car finalement, Raw Power est plus resté dans les mémoire comme une unité indivisible que pour les morceaux qui le composent eux-mêmes. C’est cette unicité qui fait son premier mérite. Il contient de la première à la dernière note la même rage incontrôlée et la même énergie débordante. Dépassant le hard-rock et préfigurant un punk auquel il survivra, Raw Power reste le mètre étalon de la hargne. Dans le pilonnage de tympans des frères Asheton se glissent cependant une vivacité musicale presque surprenante, fruit du jeu du maître des riffs qu’est James Williamson. Cela permet quand on y regarde de plus près de trouver des chefs-d’œuvre à l’intérieur de ce monument historique.
Quiconque ne connaît pas les deux titres d’ouverture a un sacré manque de culture à combler. On pardonnera quelques égarements sur la connaissance du reste du disque, mais ces deux puits sans fond sont si incontournables qu’on ne sait plus comment en parler. Traversé de part en part par un riff brutal, "Searche & Destroy" se voit pourtant dynamité par une seconde piste de guitare perçant les tympans dans les aiguës de ses solo. Iggy Pop y cherche la mort et la destruction, échappé qu’il est du cauchemar de l’Amérique, napalm brûlant tout droit venu du Viet-Nam. Après ça, "Gimme Danger" est sensé être une ballade. Effectivement elle ne s’ouvre pas sur un riff carnassier et Iggy ne hurle pas à la mort. Par sa douceur apparente, elle désarme l’auditeur… pour mieux le prendre à revers. On devrait s’y attendre quand une deuxième piste de guitare apparaît, suivie d’une troisième, mais à chaque écoute on se laisse prendre par les frissons des cris d’Iggy. Modèle d’intensité, modèle de monté en puissance, ce genre de torture mentale pour mélomane masochiste n’a pas son pareil.
Mais le temps passe et il semble impossible de traiter totalement des trente quatre minutes de métal en fusion qu’est Raw Power. Le pouvoir cru, saignant. Toujours habités du pouvoir envoûtant de Fun House mais débarrassés de la longueur par leur nouveau guitariste, les Stooges mènent chaque titre à toute vitesse. "Penetration" se trouve être le morceau le plus… pénétrant. Iggy se fait séducteur, la guitare laisse un peu de place à quelques notes de piano retentissant étrangement, on croirait voir une version boostée du génial Dirt, ou bien le retour encore noirci des pires horreurs inventées par le Velvet Underground. D’ailleurs tout est résolument boosté dans ce disque, poussé au maximum. Il y a même une seconde « ballade », celle de la deuxième face bien sur, "I Need Somebody". En fait de ballade on a surtout droit à un riff ralenti, plombé à l’extrême, et à un chant plus traînant. Encore un envoûtement réussi sans rite vaudou.
Evacuons le reste rapidement, comme le fait la musique. "Raw Power", la chanson, est un condensé de l’esprit ambiant. "Shake Appeal" se fait presque dansante, mais avec la folie ambiante on dira plutôt délirante. Le riff se mélodise, Iggy twisterait presque, mais tout est toujours noyé dans le même venin. Autre grand rock, "Your Pretty Face Is Going To Hell" est un message adressé aux plus belles femmes… Iggy maudit à tour de bras, un peu tout et n’importe quoi, mais ça n’est pas bien grave, l’effet est saisissant. Encore un riff et des soli de flammes glaçant le corps, à l’image de "Search & Destroy". Mais les lignes et le temps passe, le disque va s’achever sur "Death Trip". La mort est certaine mais évoque toutes les renaissance à venir. Le punk va prendre la relevé quatre ans après Raw Power, alors que le disque commencera à faire son chemin vers le statu d’œuvre culte. En même temps Iggy renaîtra de ses cendre grâce au soutien de David Bowie qui l’entraînera dans une carrière solo fructueuse. Quelques années de plus et c’est les Pixies et Nirvana qui feront revivre le mythe de Raw Power, et aujourd’hui encore, on ne peu pas prétendre en avoir fini avec un disque aussi acéré que son acier tranchera encore pour quelques générations.
--------------------
*** Et c'est ainsi qu'Allah est grand. ***
O.D.ed on life !
|
|



|

|
 Cachée Cachée

|
|

.

-= Chaos Servants =-
Inscription le 11-01-03
Messages : 1232
 Age : 42 ans Age : 42 ans
Lieu de résidence :
|

|
|
|
|
Réponse au Sujet 'The Stooges' a été posté le : 22/05/07 15:32
|
Et pour finir la dicographie du groupe, la chro du dernier album que j'avais déjà publié sur le forum...

La presse rock actuelle est divisée en deux grandes catégories. Dans l’une apparaît Iggy Pop, dans l’autre non. Depuis pas mal d’années maintenant, à l’occasion de nouveaux albums, de tournées, ou simplement pour remonter le niveau ambiant, Iggy traverse régulièrement nos lectures, et même les plus réfractaires à son art doivent bien reconnaître qu’avec son cocktail d’humour et de révolte, chacune de ses interviews vaut bien un an d’abonnement aux Inrocks. Côté musique, par contre, les beaux jours semblent loin dernière nous. A la notable exception de l’impudique mais sobre Avenue B, rien de majeur n’était sorti sous le pseudonyme d’Iggy Pop depuis 1977. Et comme chacun sait, à la notable exception de quelques dizaines de compiles (souvent intéressantes, voir le catalogue de Bomp!), rien du tout n’était sorti sous le fier patronyme des Stooges depuis 1973. Trois chefs-d’œuvre en cinq ans pour les charlots de Detroit, trois autres grandes réussites en trente ans pour le charlot en chef, les mathématiques elles-mêmes encourageaient à la reformation des Stooges. Plaisir, gros sous et tournées étant à l’ordre du jour pour le groupe depuis sa renaissance sur les cendres du tragique Skull Ring en 2003, l’heure est maintenant au nouvel album. Les plus patients l’auront attendu 34 ans. Aujourd’hui ils crient au génie d’Iggy et à la renaissance du rock qui de toutes façons ne pouvait pas mourir avant son plus grand symbole… et blah blah blah comme le disait l’intéressé lui-même. Une fois de plus en ce printemps 2007, les interviews d’Iggy sont mille fois plus intéressantes que tout ce qu’on écrit sur lui, moi compris.
Revenons-en à l’enthousiasme débordant de mes petits camarades dont la sagesse populaire nous assure pourtant qu’ils sont injustement payés pour descendre des disques qu’ils n’écoutent pas. Première conclusion hâtive, j’en déduirais que la bizarrerie à la limite de l’anachronisme qu’est l’existence d’un nouvel album des Stooges a dû échauffer bien des platines. Mon petit doigt me suggère même que tous les professionnels de la profession l’ont écouté en boucle. On en a trop parlé, on a trop fantasmé autour du mythe des Stooges, devenu l’égal de ceux de Frankenstein et Dracula dans la culture populaire, on a trop attendu pour que les choses se passent normalement. Autour d’un album comme celui-ci, tout est amplifié à l’excès, le bon comme le mauvais. Il semble que ce soit tout de même le bon qui l’ait emporté vu les critiques exagérément positives que l’on lit un peu partout, jusque dans ces journaux gratuits qui n’abordent pourtant que les sujets qui ont déjà été épuisés par les autres feuilles de choux. En réalité, je vous l’annonce, The Weirdness est ce qui se fait de plus proche de la boite de Pandore en matière de rock aujourd’hui, mais symboles et fantasmes mis à part, ce disque ne va rien changer à nos vies.
Le simple fait d’écouter un tel album aujourd’hui, c’est le risque de casser le mythe. Si la somme critique et musicale bâtie sur les fondations que constitue l’œuvre première des Stooges venait à être remise en cause, c’est toute la batisse rock qui se casserait la gueule. Non, arrêtez de rêver, on sait que ça n’arrivera pas, je disais ça pour l’image ! Quoi qu’il en soit, il fut décidé qu’on ne verrait pas ça arriver, et le disque fut bon. Même s’ils ne se sentent plus *******er, on ne va pas reprocher aux critiques de passer complètement à côté de la plaque. The Weirdness est un putain de disque, concis comme il se doit, rapide comme on l’attendait, et habillé d’un jean pile poil deux tailles trop petit. Un disque à l’image d’Iggy Pop, et surtout son premier « all killer, no filler » depuis Raw Power. Pas rien, finalement, mais pas « tout » non plus. Le son, par exemple, ne fait pas honte à la réputation de Steve Albini, mais ne mérite pas tant d’éloges sonores. J’aimerais rappeler qu’un son ferme, sec, électrique, qui sonne « vrai », c’est le minimum syndical pour un disque de rock. A moins de voir se reproduire le ratage de Raw Power ou la prouesse de son remixage, arrêtons de parler de mixage à tout bout de champs, et contentons-nous de savoir que l’enregistrement de The Weirdness fait honneur à son contenu, c’est le principal.
40 minutes pour 12 titres, soit une moyenne de 3:33 minutes par morceau, et les durées de 2:07 et 4:05 aux extrêmes. Quelques chiffres qui donnent la mesure. Autre détail, pas de ballades. Juste deux titres à part, tempos ralentis, mais pas Gimmer Danger ou Dirt. Dans le reste, aucun T.V. Eye, on est pas revenu à Fun House malgré le saxophone présent sur pas mal de titres. Résultat de l’équation, The Weirdness est un disque de rock impalpable, mais pas le retour au style précédent des Stooges. Reste du groupe une recherche sonore à partir d’un matériel minimal et une volonté de précision dans l’écriture qui le rendent unique. Mur de guitare et batterie pilon chez les deux stooges Asheton, et une basse à l’avenant par Mike Watt, riffs et rythmique s’entremêlent dans le magma sonore pour propulser la voix, Iggy Pop, qui chante faux. C’est parfois assez impressionnant, et l’impression est positive.
Tout ceci étant dit, le mérite principal que j’accorde à The Weirdness est son potentiel à échapper à toute critique constructive. Il y a tant à dire sur le buzz qui l’entoure, mais si peu sur le disque. Argument positif, me semble-t-il : oserez-vous contrer l’argument qu’un disque de rock se suffit à lui-même et qu’une fois écartées les critiques et craintes habituelles, il est le seul à pouvoir parler à chacun de ses auditeurs ? Si vous êtes de cet avis, vous êtes dans le bon état d’esprit pour vous confronter au nouvel album des Stooges. Vous tremblerez à l’écoute du pont de My Idea Of Fun, vous vibrerez probablement au rythme ralenti et légèrement free du morceau titre et de Passing Coulds. Je n’aurai pas la condescendance d’affirmer que ce disque n’a pas d’autre ambition que de nous faire tripper. Ce serait faux. Iggy est resté un éditorialiste de talent, épinglant les bobos (Greedy Aful People), les femmes interessées (She Took My Money), l’Eglise (End of Christianity), le tout soutenu par quelques billets d’intention (l’ouverture « I’m trolling » qui annonce la sauce) ou autres professions de foi (My Idea of Fun… « is killing everyone »), le tout dans l’esprit rock inauguré par les Stooges à l’époque où leurs concerts étaient parmi les plus mal vus qui soient. Ils sont aujourd’hui rangé dans les actes, respectables dans une industrie capable de digérer les pires trublions, mais n’ont pas perdu leur mauvaise esprit, le fond de leur pensée.
The Weirdness s’adresse donc avant tout – hors fans des Stooges bien sûr – à ceux auxquels les simples mots « un disque de rock » évoquent un plaisir, lorsqu’ils ne sont pas accompagnés d’autres fioritures. Sans réécrire l’histoire, le trio de Detroit (rock city !) reste à notre époque l’un des groupes au son le plus reconnaissable. Dans la mesure où l’on précise que les chansons sont bonnes, ce fait est un gage de qualité suffisant. C’est l’ABC du rock : un style, un son, des chansons. Tournez la page messieurs les rêveurs, Iggy ne sauvera pas le rock, on n'entendra pas de jeunes groupes crier au long de leurs albums combien ils doivent à The Weirdness comme ce fut le cas pour Fun House et Raw Power, mais l’album lui-même est bon, ça suffira ! Envoyez chier l’histoire et les discussions de routine, écoutez la musique.
--------------------
*** Et c'est ainsi qu'Allah est grand. ***
O.D.ed on life !
|
|



|

|
 Cachée Cachée

|
|