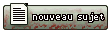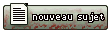.

-= Chaos Servants =-
Inscription le 11-01-03
Messages : 1232
 Age : 42 ans Age : 42 ans
Lieu de résidence :
|

|
|
|
|
Brian Setzer a été posté le : 31/07/06 10:48
|

Mais ne parlons pas de l’avenir, revenons dans le passé pour un rapide panorama sur la carrière de ce guitariste virtuose. En près de trente ans il a imposé un style et développé la variété d’une personnalité parmi les plus fortes du rock and roll moderne.

Brian Setzer est né dans la banlieue New Yorkaise en 1959. Eddie Cochran était déjà mort, et le jeune fan de rockabilly ne se remettra jamais d’avoir raté ça. Adolescent, il développe un certain talent de guitariste en restant dans l’ombre de ce model : de l’attaque des cordes au choix des accords, de la coiffure pompadour importée de Nashville au choix de la mythique guitare gretsch, il se pose en héritier de l’auteur du Summertime Blues. A 20 ans, il a déjà fais ses premières armes comme pro de la six-cordes avec les bien nommés Bloodless Pharaohs, et il forme les Stray Cats. On est en 1979 et le rockabilly n’a pas droit de cité, seuls les punks et la new-wave occupent les scènes new-yorkaises. Cela n’aura pas grande importance : Brian Setzer (guitare, chant), Lee Rocker (contrebasse) et Slim Jim Phantom (batterie) cachent sous leurs dehors très « back to the fifties » un vrais tempérament de porteurs d’épingles à nourrices. Leurs compositions sont parmi les premières à donner la ferveur du rock actuel à un style que l’on croyait mort avant même qu’Elvis ne soit enlevé par les extra-terrestres.
Exilés à Londres où le public leur confirme chaleureusement qu’on est jamais prophète en sont pays mais qu’on peut brûler les planches outre-atlantique, le trio offre au monde (et à l’Europe en particulier) un premier album. Rock This Town, Runnaway Boys, Rumble In Brighton : autant de rocks sans concessions où Brian étale une virtuosité à toute épreuve, concentrant son attention sur des riffs et des gimmicks de gratte éjaculés à plein amplis et soutenus par une pléiade de power-chords que Link Wray n’aurait pas renié en 1958. Pas une note qui ne soit justifiée, pas une seconde de branlette vaine, lorsqu’il prend son manche en main tout est indispensable. Les paroles sont retro, la musique évoque le passé, mais le guitariste et ses deux compères trouvent dans l’attitude le moyen de ne jamais paraître dépassés par les évènements. En cela, les Stray Cats ont déjà tout compris : les Clash eux mêmes affichent leur goût pour le vieux rockabilly dans leur vêtements et quelques morceaux comme la reprise du Brand New Cadillac de Vince Taylor. Avec sa belle gueule d’ange blondinet qui n’a rien à envier à celle de Paul Simonon, Brian Setzer est le leader parfait pour l’époque. Son talent de guitariste ne le mène jamais à la démonstration vaine qu’auraient détesté les punks, et sa voix encore bien limitée lui permet de s’exprimer en hauts cris parfaitement en adéquation avec les sonorités de son temps.
Le cocktail fonctionne, et le groupe devient le fer de lance d’un rockabilly revival que le très conventionnel premier album de Robert Gordon avait lancé deux ans avant, et qui conduira à la vague psychobilly caractérisée par les Cramps. Les Stray Cats dominent tout ça d’une bonne tête, et son occupés à jouer autant que possible, partout, très fort : ils triomphent en Allemagne dans l’émission rockpalast. Le public qui découvre le jeu brûlant de Setzer, Slim Jim debout devant son kit de batterie minimaliste (si ça c’est pas punk !), et Lee Rocker faisant tournoyer son imposant instrument… ce public est toujours ravis. La part de spectacle, la proximité avec le public que les punks avaient ravivés alors que les dinosaures du rock (Led Zep et les Stones, pour le pas les citer) s’essoufflaient sur des scènes plus grandes qu’eux : les Stay Cats ont cela et en font leur argument de vente numéro un.
Mais ça ne fait pas d’eux de simples phénomènes de scène. Brian est un vrais compositeur, et le morceau le plus connu de ce premier album le prouve, devenant sa signature : Stray Cat Strut. Nonchalant, jazzy, voilà un rock qui ondule de la croupe. Richard Hell avait déjà joué à peut prés la même chose dans son génial Blank Generation (toujours les punks…), mais les Stray Cats l’enfoncent à coup de fluidité, de tempo… de swing (que BatPoulet me pardonne). Les soli sont courts, comme toujours, mais pas fulgurants comme sur Rumble, plutôt coulant directement de la source de l’inspiration, quelques notes balancées entre chaque couplets pour colorer le tout. Et puisqu’il ne faut pas encenser seulement le boss, on précisera que la section rythmique de Lee et Slim Jim est à cet instant là la meilleure du monde, tendue comme une corde de contrebasse prête à claquée, mais capable de se retenir pour offrire un groove à la sensualité très black (l’érudit notera que le trio a repris – sans grande inspiration – le tube Motown qu’est You Can’t Hurry Love sur une face b de l’époque). Les paroles ne sont pas en reste, le « feline casanova » y définit tout son style, et y fait sans mauvais goût l’étalage de sa classe sans égale. Paumé bagarreur, et pourtant brave séducteur. Le Stray Cat de ce temps là n’est pas celui de la décennie précédente, pervers malveillant chanté par Mick Jagger. Setzer revient bien plus loin que les Stones, et retrouve l’énergie adolescente du rockabilly : Eddie Cochran, Gene Vincent, Jerry Lee Lewis, et même Dick Dale (tiens, pour une fois il n’y a pas Chuck Berry). Il insiste même – le bougre – en reprenant le classique Jeannie Jeannie Jeannie. C’est un morceau simple, mais un vrais casse gueule à reprendre (comme tous les bons rocks qui ont connu une version « définitive » il y a quelques décennies). Il faut être rapide sans s’emporter, gueuler dans le micro jusqu’à le faire grincer, mais sans oublier qu’on parle à une dame. Bref, il y a plein de règles à la subtilité désarmante pour faire un bon, vrais, vieux, rock qui roll. Brian Setzer les maîtrise toutes comme personne ne l’a fait depuis que les anglais ont pris possession du sol américain en 1964.
D’autres tubes dignes des ancêtres sont à citer : Ubangi Stomp (les sauvages), Fishnet Stockings (les pin-up), Double Talking Baby (l’amour), avec chacun son ambiance, mais toujours le même tempérament bien trempé. On conclura – comme le fait l’album – sur la note exotique du Wild Saxophone final, qui laisse l’oreille éveillée : ce mec la cache quelques autres cartes dans sa manche, mais il va falloir patienter encore un peu pour les découvrir. Conclusion ? La façade de ce disque a foutrement vieillit, en matière de qualités sonores en particulier. Il ne claque pas autant qu’il devrait (et je ne parle que de la seule version que je connais, le LP… le cd est peut être bien pire, on n’espérera donc même pas qu’une remasterisation arrange les choses!). La voix de Bran Setzer de son côté est très faible, il manque de coffre et de timbre, et compense juste assez par la fougue. Pourtant, sur le fond, on tient là un disque historique, et sans doute la meilleure collection de chansons (car c’est ça le plus important) que le guitariste ait jamais réunies, même si il a donné par la suite des versions plus maîtrisées de presque tous les titres ici présents. On se reportera éventuellement au très professionnel live Rumble in Brixton (2004), mais sans oublier que c’est avec ces versions studio que l’histoire a été écrite.

Bon, j’en ai peut être tartiné un peu trop pour une discographie commentée, je vais survoler plus rapidement la suite des évènements, bien qu’elle reste tout aussi passionnante. Second album, toujours sur le label Arista et la même année que le premier (1981, si j’ai oublié de le préciser). On reste dans l’indispensable. La pochette montre bien que la tendance est toujours à l’americana idéalisée et au 50’s façon chrome et cuirs noirs. Marlon Brando est l’idéal masculin, Marilyne la plus belle femme du bonde. Mais ça n’est pas vraiment la question. J’ai défini le premier album comme étant bourré de vrais tubes. Gonna Ball est plus subtil. C’est un vrais disque, avec moins de morceaux renversants et indépendants, mais qui fonctionne mieux dans son ensemble. Déjà, le son est meilleur et Brian qui n’a pas encore de timbre bien marqué (putain, il est plus jeune que moi !) fait quelques efforts pour chanter correctement. Ca passe sans trop d’accrocs. Le tempo de son côté est passé du galop à un trot distingué. Resté sur la note du Wild Saxophone, Setzer multiplie les arrangements bien plus complexes que le simple guitare/basse/batterie, et la beauté de l’ensemble s’en trouve renforcée. Les genres, enfin, sont plus discrets. On a plus affaire à un rockabilly écrasant, mais à un rock en tenue de soirée. Même lorsqu’ils donnent dans la débauche métallique, les Stray Cats varient les sonorités : écoutez le slide de Wicked Whisky, totalement inimaginable sur le premier album ! Sinon, Rev It Up And Go et Gonna Ball sonnent comme un vrais vieux rockabilly, Crazy Mixed-up Kid a un son crade du genre garage et plein de branlage de manche jouissif, Little Miss Prissy est teintée de psychobilly, et le Baby Blue Eyes d’ouverture se la joue roucoulade. Ca c’est pour les rocks, la moitié de l’album la plus proche de ce qu’on a connu.
L’autre moitié, c’est de l’harmonica, du saxophone, des guitares superposées, des voix graves, du swing… comme si Brian Setzer rêvait déjà son big bang de dans dix ans. Pour la tendance générale, c’est la maîtrise instrumentale qui frappe. Les trois musiciens jouent dans une tonalité parfaite, quelle qu’elle soit. Entendez la discrétion de la guitare dans Wasn’t That Good, elle se dédouble pour un solo paradoxale, laisse la place à un saxo, la rythmique tortille très en avant, et c’est le swing qui y gagne. La chanson y gagne.
Moins urgent et dévastateur que son prédécesseur, Gonna Ball est l’album de la maîtrise. La fin de l’adolescence et l’ouverture à une diversité musicale remarquablement mise au service du rock and roll pas si traditionaliste que ça dont Brian Setzer s’est fait le paladin. Sans créer de nouveautés éblouissante, il va piocher ses idées parmi des influences nombreuses et éclectiques, et forge son style dans un alliage qui a déjà fais ses preuves. Ca n’empêche aucunement la qualité du forgeron d’être unique.

1982 : changement de label et retour aux Etats Unis où le succès déjà bien établi en Europe se fait attendre. Plutot que de simples rééditions, c’est un mix des deux albums qui sera effectué en terre yankee, Built For Speed. La compile insiste sur les rocks et c’est dommage quand on se souvient du bien que j’ai dis des subtilités de Gonna Ball. Mais qu’importe, le résultat est tout de même un truc énorme, parfaitement en adéquation avec son titre. Pour certains, le meilleur disque des Stray Cats.

La formule ne change pas et les Stray Cats enregistrent déjà leur dernier grand album en 1983. On revient même légèrement en arrière (pas forcément en mal) puisque Brian Setzer écrit plus sous la forme single que pour l’album. Ca sent encore les tubes, moins cultes que sur le premier album mais tout de même bien torché et génialement interprétés. Too Hip Gotta Go par exemple, est parfaitement irrésistible. Très léger, sans la moindre once d’agressivité, il mise tout sur un swing que le trio maîtrise plus qu’à ses débuts. On trouve deux gros rock parmi les classiques écrits par Brian Setzer : Something’s Wrong With My Radio et (She’s) Sexy + 17. Dans les deux cas il joue d’une grosse voix assez braillarde, dans les refrains en particulier. Mais c’est surtout avec la ballade I Won’t Stand In Your Way que l’on ressent le changement qui marque l’album : Brian Setzer commence à se muer en un bon chanteur. Non seulement il a appris à maîtriser sa voix et chante toujours juste, mais surtout son timbre s’adoucis, il gagne quelques notes plus graves qui l’aident dans une interprétation toujours plus subtile.
A part ces remarques, Rant ‘n’ Rave with the Stray Cats est un disque de rock and roll assez classique, toujours bon et efficace. Peut être la formule s’essouffle t elle un peu, comme semble l’indiquer la suite des évènements, mais on reste pour l’heure dans la qualité.

Ce Rock Therapy est considéré comme un album anecdotique de la discographie des Stray Cats. Etant donnée l’absence de classiques parmi les morceaux qui le composent, on s’en tiendra là. Il faut bien dire que lorsqu’il perd son inspiration de compositeur, Brian Setzer n’est alors pas capable de sauver les meubles par la seule interprétation... De plus les Stray Cats commencent à souffrir des tournées intensives, comme tous les groupe de scène. L’intensité épuise. Conséquence : cette même année 1986 marque les débuts de Brian Setzer en solo, mais je vais faire une pause avant d’en parler… la suite au prochain numéro, donc.
|
|
Dernière mise à jour par : ZiGGy le 31/07/06 17:37
|
--------------------
*** Et c'est ainsi qu'Allah est grand. ***
O.D.ed on life !
|
|



|

|
 Cachée Cachée

|
|